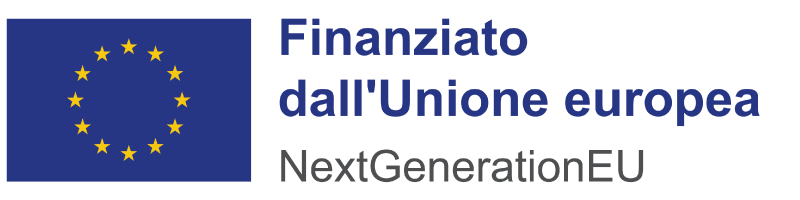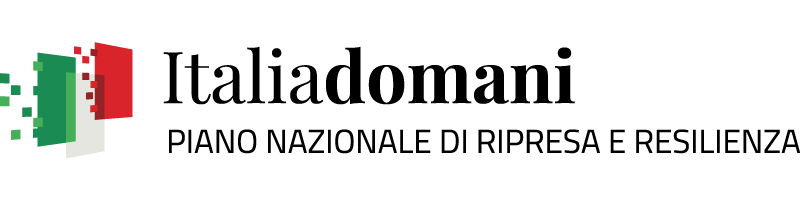Nicole Bingen, Jean-Pierre De Mesmes : À propos de deux contributions récentes, in « Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance », LXVI, n. 2, 2004, pp. 331-357
Nicole Bingen, Sources et filiations de la Grammaire italienne de Jean-Pierre De Mesmes, in « Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance », 1984, t. 46, n. 3, pp. 633-638
Isabelle Pantin, Jean-Pierre de Mesmes et ses“Institutions astronomiques” (1557), « Bulletin de la société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn » 13, 1986, pp. 167-182
Émile Picot, Les Français italianisants au XVI siècle, Paris, Champion, 1906
Daniele Speziari, Tradition et innovation du vocabulaire astronomique français dans les Institutions astronomiques de Jean-Pierre de Mesmes et dans le Traité de la composition et fabrique de l’astrolabe et de son usage, « Studi Francesi », n. 206, 2025, pp. 395-408.